

Mezquita-Catedral de Cordoba
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

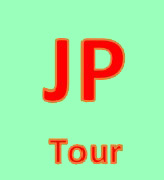
 |
 |
Mezquita-Catedral de CordobaCatedral de Nuestra Señora de la Asunción |
 |
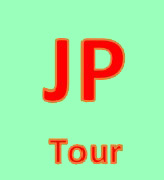 |
||
| Andalousie | Cordoba | C/ Cardenal Herrero n. º 1, Cordoba |
| Califat | Wisigoths | Omeyade | Ame de Cordoue |
L'ensemble monumental de la mosquée-cathédrale de Cordoue propose la belle complexité de l'intégration des styles et des supports artistiques les plus divers. De l'hellénisme au baroque, en passant par la splendeur califale, ce bâtiment nous offre une vision complète et irremplaçable de l'histoire de l'art, un riche dialogue entre les cultures. Sa carrière, en tant que basilique wisigoth primitive, Aljama et plus tard cathédrale, montre bien que nous sommes face à un bâtiment vivant, un bâtiment qui s'est perpétué au fil des siècles. Nous sommes face à une architecture exceptionnelle et prodigieuse qui continue de provoquer l'émotion et la perplexité de tous ceux qui la contemplent. |
La mosquée-cathédrale de Cordoue, également connue sous son ancien nom de « mosquée de Cordoue » (Mezquita de Córdoba) et sous son nom canonique et officiel de cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption (Catedral de Nuestra Señora de la Asunción), est un ancien temple romain qui devint basilique chrétienne, du ive au viiie siècle, du temps de la monarchie wisigothique, puis une mosquée, du viiie siècle jusqu'au 29 juin 1236, date à laquelle elle a été consacrée comme cathédrale, dans laquelle fut érigée plus tard, au début du xvie siècle, une chapelle dite majeure (en espagnol, Capilla Mayor) (pour la distinguer des nombreuses autres chapelles plus anciennes, situées le long des quatre murs intérieurs de l'édifice, à l'exception de la Capilla Real (Chapelle Royale), de la Capilla de San Pablo (Chapelle Saint-Paul) et de la Capilla de Villaviciosa (ancienne Chapelle majeure de la cathédrale du xiiie au xvie siècle), lesquelles ne s'adossent pas au quadrilatère formé par les murs nord, ouest, sud et est. C'est un monument majeur de l'art des Omeyyades de Cordoue dans son expression la plus accomplie, et le témoin de la présence musulmane en Espagne du viiie au xiiie siècle ; il a été précédé par une première et monumentale basilique chrétienne wisigothique, puis suivi depuis le xiiie siècle par l'actuelle cathédrale catholique. Une première « parenthèse » catholique (depuis l'antique basilique wisigothique, qui était sur le site jusqu'au début du viie siècle) eut lieu du 18 au 30 mai 1146 lors de la brève reconquête de la ville par le roi Alphonse VII. Le monument redevint église au xiiie siècle avec la Reconquista menée par le roi Ferdinand III de Castille qui aboutit le 29 juin 1236 ; depuis cette date, il est la cathédrale du diocèse espagnol de Cordoue. Souvent appelé « mosquée-cathédrale » dans le langage courant, le monument a été classé au patrimoine mondial par l'Unesco en 1984. |
 |
 |
 |
 |
||
 |
||
| Type | Culte | Diocèse | Style | Année de contruction |
Longueur | Largeur | Hauteur | Superficie | Périmètre | Volume | Inclinaison |
| église cagthédrale |
catholique | roman gothique baroque |
km |
km | m | km2 | km | km3 |
| Heures d'ouverture - réservation obligatoire / facultative | Fermeture suppl | ||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
| Mosquée-cathédrale | |||||||||
| février | De 10:00 à 18:00 ! horaire de culte | ||||||||
| avril | |||||||||
| Tour - Clocher | 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 et 17:30. | ||||||||
| Ame de Cordoue | 21:00 et 23:00 | ||||||||
| Mosquée-cathédrale |
|
|
| Route des Églises Fernandines | La Route des Églises Fernandinas propose une intéressante visite du patrimoine à travers huit temples fondés sur l’ordre de Ferdinand III El Sant. Ce complexe architectural est l’une des manifestations essentielles de la contribution du monarque à la trajectoire historique de Córdoba. Ce sont également des temples vivants qui conservent leur fonction liturgique et ont réussi à recueillir les contributions plastiques de tous les époques. | |
| Tour - Clocher | La Tour-clocher est, sans le moindre doute, l’un des icônes les plus emblématiques de la physionomie urbaine de la ville de Cordoue. Fermée au public dans la décennie des années 90, ce ne sera qu’en novembre 2014 qu’elle sera rouverte comme nouveau point attractif pour le visiteur. Il ne s’agit pas seulement d’un magnifique exemple architectonique, mais aussi un belvédère privilégié, le plus haut de Cordoue. Depuis sa hauteur, il est possible d’embrasser tout l’Ensemble Monumental et la ville d’un nouveau point de vue. |
|
| "L’Âme de Cordoue" | La visite nocturne nous propose une manière nouvelle et surprenante de redécouvrir l’ensemble architectonique. La lumière, le son et l’image s’unissent pour transférer au visiteur une connaissance profonde du monument, depuis une perspective historique et artistique et depuis sa signification religieuse. Le patrimoine et la technologie se fusionnent et créent un parcours pour les sens. Ce spectacle nocturne débute dans la Cour des orangers, avec une projection cinématographique qui retrace l’histoire de l’édifice et de la ville. Ensuite, le visiteur parcourt l’Ensemble Monumental et connait ses points principaux. |
|
| Prix - online uniquement | Entrée gratuite | Paiement - Cartes acceptées | |||||
| Adulte | Adulte > 60 - 65 | Etudiant | Enfant | Groupe | |||
| Mosquée-Cathédrale & Eglises Fernandines | 13 € | 10 € | |||||
| Ame de Cordoue - Visite nocturne | 20 € | 14 € | |||||
| Tour-Clocher | 3 € | ||||||
| Comment y aller ? | Itinéraire | |||||
| Mode | Arrêt | Prendre | Orientation | Distance | Durée | |
| Puerta del Puente | L 3, 12 | |||||
| Ensemble Monumental Mosquée -Cathédrale de Cordoue”, C/ Torrijos n. º 6 | ||||||
Personnalités |
| Lampadio, Agapio et Eleuterio
Moitié de la deuxième partie du VIème siècle
Lampadio (+549), Agapio (avant 589 - c.591) et Eleuterio (591 – post 597) sont les évêques qui se succèdent à Cordoue, durant la deuxième moitié du VIème siècle, dans la période chronologique qui coïncide avec la datation des vestiges appartenant au complexe de la basilique de Saint Vincent. Le témoignage de leur présence est fondamental pour constater l’existence du siège épiscopal fondé par Osio, d’une administration diocésaine et d’une « Domus episcopalis ». En ce qui concerne Lampadio, nous conservons sa pierre tombale, exposée au Musée Archéologique. Quant aux évêques Agapio et Eleuterio, nous savons qu’ils assistèrent au IIIème Concile de Tolède. |
| Abderrahmane I
756-788
Membre de la dynastie omeyyade et petit-fils du calife Hicham de Damas, il parvient à s’échapper des abbassides et arrive dans la péninsule ibérique. Son périple de Cordoue commence avec la conquête de la ville après la victoire de la bataille de Al-Musara, le 14 mai 756. Cette même année, il déclare l’Émirat indépendant de Cordoue et devient le premier émir de Al Andalus. La demande de culte musulman, initialement réalisé dans l’ancienne basilique de Saint-Vincent, l’oblige, à la fin de sa vie, à diriger ses efforts vers la construction de l’Aljama. Quoi qu’il en soit, cette décision correspond à une décision non seulement religieuse mais aussi politique, comme manifestation du pouvoir de l’émirat de Cordoue. |
Abderrahmane II 822-852
Fils d’Al-Hakam I, son gouvernement d’Al-Andalus, compris entre 822 et 852, est intéressant, non seulement du point de vue politique, mais aussi de par sa dimension culturelle. La Cordoue de cette époque acquiert une image de cour majestueuse qui se projette au niveau international, et devient une référence des arts et des lettres. Sous son émirat, de nombreux ouvrages civils sont construits, en relation à la muraille et aux infrastructures hydrauliques. Quoi qu’il en soit, son legs matériel le plus visible est perçu dans le cadre de la mosquée de Cordoue au travers de ses premiers agrandissements. |
| Abderrahmane III
929-961
Abderrahmane III est proclamé calife, en instituant le Califat de Cordoue en 929. La ville atteint son apogée du point de vue social, économique et culturel. En outre, la capitale devient un centre d’importantes relations commerciales à caractère international. Sans le moindre doute, ses efforts ont porté sur la construction de la ville palatine de Medina Azahara, résidence du Calife, mais aussi siège de son administration. En outre, et sans surprise, il intervient dans la construction de la grande Aljama de Cordoue. Son apport à la mosquée sera la construction du grand minaret et de la façade de l’oratoire qui se projette vers la cour. |
| Alhakén II
961-976
Il prend la succession de son père Abderrahmane III en l’an 961. Outre ses occupations politiques, les sources le décrivent comme une personne très religieuse, très intéressée par la culture, comme le démontre la création de la bibliothèque la plus importante d’Occident, contenant plus de 400.000 volumes. Depuis le début, et au vu de l’incroyable augmentation de la population de Cordoue de confession musulmane, il s’engage à entreprendre l’agrandissement de la mosquée, et sa contribution sera celle qui présente la plus grande richesse et qualité plastique. Il fit aussi réformer l’alcazar califal et réalisa d’importantes contributions pour améliorer les infrastructures de la ville. |
| Almanzor
981-1002
Le décès prématuré d’Al-Hakam II fit monter au pouvoir le prince Hicham II, qui n’avait alors que onze ans. Cette situation est utilisée par Almanzor qui, jusque-là, avait eu des fonctions importantes dans l’administration califale. Après une période dans laquelle il exerce le rôle de tuteur du prince, en 978, sa stratégie et ambition le poussent à se nommer hadjib, ce qui lui permet d’imposer son autorité absolue. Au long de sa vie, il participe à de nombreuses campagnes militaires victorieuses. Cependant, au-delà de sa facette militaire, il fit agrandir la Mosquée de Cordoue et lui conférera l’espace que nous lui connaissons aujourd’hui. |
| Enrique de Arfe
1475-1545
Cet orfèvre d’origine allemande est, sans le moindre doute, un des premiers artistes qui introduisit le nouveau langage dans la ville de Cordoue. Enrique de Arfe reçoit du Chapitre de la Cathédrale l’ordre de réaliser la Custode processionnelle de Corpus Christi, et nous savons qu’en 1514, il y travaillait déjà. On lui attribue aussi la Croix de la procession de l’arcedi. |
| Obispo Íñigo Manrique
1486-1496
Il fit construire la nef gothique, qui est aussi le premier grand ouvrage d’adaptation au culte chrétien de l’ancien oratoire musulman. Un autre de ses apports à l’édifice est la Croix processionnelle qui est conservée dans le Trésor de la Cathédrale. Sa mémoire est aussi matérialisée dans deux inscriptions localisées dans l’enceinte. D’un côté, celle qui se réfère à l’existence de son enterrement dans le transept, sous l’orgue de l’épître et, de l’autre, celle qui se trouve sur une des cloches du corps de l’horloge de la Tour-clocher. |
Obispo Alonso Manrique 1516-1523
Su principal contribución fue la iniciativa de la construcción de la nueva capilla mayor. Las obras, dirigidas por el maestro mayor Hernán Ruiz I, fueron iniciadas en 1523, como nos recuerda una inscripción situada en uno de los arcos del crucero. El desarrollo del proyecto presenta diversos avatares históricos y se prolongará a lo largo del tiempo. El legado del obispo Manrique perdura también en una de las campanas de la torre. Asimismo, su escudo puede ser contemplado en la capilla de San Clemente. |
Pablo de Céspedes 1538-1608
Cet humaniste et peintre de la Renaissance, exerce la fonction de prébendier de la Cathédrale de 1577 à 1608. Son critère esthétique est évident dans les ouvrages qui lui sont commandés durant cette période. D’autre part, comme peintre, il produit la Sainte Cène, et on lui attribue aussi le Baptême de Jésus de la Chapelle du Saint Esprit et les peintures du retable de Sainte Anne. Il est enterré dans l’Ensemble Monumental, près de la chapelle de la Conversion de Saint Paul. |
| César Arbasia
1547-1607
Il est bien probable que ce fût Pablo de Céspedes qui intervint dans le choix de ce peintre italien pour la décoration de la Chapelle du Tabernacle. Les deux avaient travaillé ensemble à Rome, dans l’exécution des peintures de la chapelle Bonfili de l’Église de la Trinidad del Monte. De son côté, dans la chapelle du Tabernacle, César Arbasia déploie un programme pictural complet axé sur les martyrs de Cordoue. Antérieurement, il travailla aussi dans le Grand Temple de Malaga, dans sa grande chapelle. |
| Évèque Francisco Reinoso
1597-1601
Ce n’est pas par hasard que les armoiries de son épiscopat soient situées dans la voûte du chœur, du fait qu’il s’agit d’un des prélats qui a lancé le projet constructif de la Cathédrale. Peu après son arrivé au siège, il visite le nouveau chantier et demande l’opinion de Diego de Pravez, architecte de la cathédrale de Burgos. Plus tard, l’achèvement de l’ouvrage sera demandé à Juan de Ochoa. La définition du programme iconographique de la voûte chorale lui correspond aussi très probablement et il participe aussi à la configuration de la cour, où il introduit un concept innovant de jardin qui explique qu’à partir d’alors il soit dénommé "des orangers". |
| Évèque Diego de Mardones
1607-1624
Sous son gouvernement diocésain, la nouvelle grande chapelle et le transept sont terminés, comme nous le rappelle l’inscription d’un des arcs de son côté méridional. Mais, en outre, la Cathédrale recevra un autre apport fondamental de la part de Mardones, avec le don de 50.000 ducats destinés au retable majeur. Comme remerciement, le Chapitre lui cède un espace pour son enterrement, visible dans la figure priante taillée par Juan Sequero de la Matilla. Un autre témoignage de son épiscopat est concrétisé dans la somptueuse "Croix processionnelle de l’évêque Mardones", réalisée par l’orfèvre Pedro Sánchez Luque et exposée à présent dans le Trésor. |
| Antonio del Castillo
1616-1668
Ce représentant fondamental de la peinture baroque à Cordoue maintiendra, tout au long de sa vie, des liens très étroits avec la Cathédrale. Ce lien fut aussi matérialisé d’une perspective personnelle, étant donné qu’il en arriva à être baptisé et marié dans la Chapelle du Tabernacle. Son apport plastique est concrétisé dans les œuvres suivantes : Saint Assiscle, Martyr de Saint Pélage, Retable pictural de Notre Dame du Rosaire, Vierge Immaculée avec Saint Philippe et Saint-Jacques le Mineur, Immaculée Conception de l’Autel de Sainte Marthe, Saint Philippe et Saint-Jacques le Mineur, Négation de Saint Pierre ou l’Immaculée Conception du Trésor de la Cathédrale. |
| Antonio Palomino
1653-1726
Son apport se concrétise dans la réalisation des cinq tableaux du retable majeur, qui lui sont commandés en 1713. Nous nous référons aux tableaux : Notre Dame de l’Assomption, Saint Assiscle, Sainte Victoire, Saint Pelage et Sainte Digna. Il est aussi l’auteur de trois œuvres de grand format qui se trouvent dans la chapelle de Sainte Thérèse: Martyre des saints Assiscle et Victoire, Apparition de Saint Raphaël au père Roelas et Remise de Cordoue à Fernando III le Saint. |
Pedro Duque Cornejo 1677-1757
Après l’exécution d’un modèle de chaise de dimensions naturelles, le sculpteur sévillan gagne le concours qui lui offre la possibilité de réaliser les stalles du chœur. Le 31 octobre 1747, le contrat est signé. Il est donc désigné maître et directeur de l’ouvrage, qui se prolongera jusqu’à sa mort, le 3 septembre 1757, deux semaines avant l’inauguration. Son dévouement aux stalles dura jusqu’à la fin de sa vie, et pour cette raison, le Chapitre lui dédia une messe solennelle et décida de lui donner sépulture aux pieds du chœur, comme nous rappelle une inscription funéraire. |
| Damián de Castro
1716-1793
Le plus prolifique des orfèvres cordouans du XVIIIème siècle sera désigné grand maître d’orfèvrerie de la Cathédrale en l’an 1752. Durant la période qui correspond à son ouvrage, il réalise des pièces d’intérêt qui peuvent être vues dans le Trésor. Les œuvres les plus remarquables sont l’Arche eucharistique du Jeudi Saint, les Ampoules du Saint Chrême, les sculptures de la Vierge de la Chandeleur et Saint Raphaël ou le Calice de l’évêque Delgado Venegas. Il réalise aussi la restauration de la Custode de Corpus Christi d’Enrique de Arfe. |
| Ricardo Velázquez Bosco
1843-1923
Cet architecte originaire de Burgos sera chargé d’effectuer les restaurations réalisées dans l’édifice depuis qu’il a été déclaré Monument National. Adepte des vues de Viollet de Duc, il intervient dans des lieux aussi différents que la Porte des Vizirs ou la Chapelle de Villaviciosa. En outre, il collabore avec Mateo Inurria, pour réaliser la toiture actuelle et remplacer le sol par un recouvrement en marbre Macael. |
| Félix Hernández
1889-1975
Durant la décennie des années trente du XXème siècle, il s’occupe des diverses recherches archéologiques qui ont lieu dans l’enceinte d’Abderrahmane I, afin d’extraire le plus possible d’information sur la Basilique wisigothe de Saint-Vincent. En outre, il rabaisse le niveau du sol de la mosquée d’origine pour dégager les bases des colonnes et il développe les travaux d’entretien des toitures. |
| Situation - Région | Pays | GPS / Lat - Long | Altitude | |
|
00° 00' 00" N - 00° 00' 00" E | m |
| Adresse | ||||
|
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services, facilités | ||||||||||||||
Audioguide |
Langues |
Wifi |
Photo - Vidéo |
Shop |
Consigne |
Vestiaire |
Cafetaria |
ATM |
Visite guidée |
|||||
| A proximité |
|||
| Musées, expositions | Restaurants, Hôtels | Parcs, promenades | Divers |
| A voir |
|
|
| A faire |
|
|
| Histoire |
| Contact - Nom | Téléphone / gsm | web | note | |
| info | ||||
| réservation | ||||
| office |
| Sites web | ||